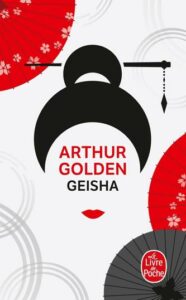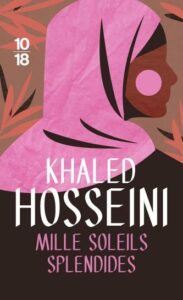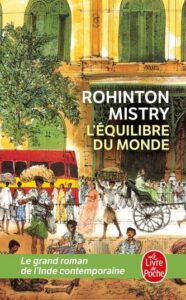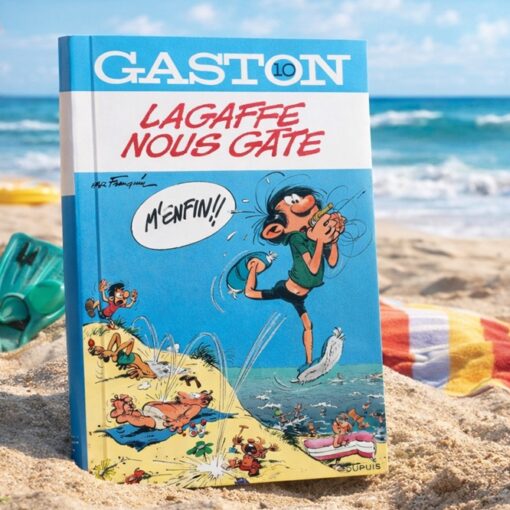Publié en 2017, Pachinko est le second roman de l’écrivaine américano-coréenne Min Jin Lee. Il retrace, sur quatre générations, le destin d’une famille coréenne contrainte à l’exil au Japon dans les années 1930. Finaliste du National Book Award et traduit dans une trentaine de langues, il s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires dans le monde. Voici quelques suggestions de lecture taillées dans le même tissu.
La famille Han (Min Jin Lee, 2007)
Premier roman de Min Jin Lee — écrit avant Pachinko mais publié après en France —, La famille Han suit Casey Han, fille aînée d’immigrés coréens installés dans le Queens. Fraîchement diplômée de Princeton, la jeune femme se retrouve tiraillée entre les attentes de ses parents, modestes propriétaires d’un pressing, et son désir de s’imposer dans la haute société new-yorkaise.
Casey veut tout à la fois : l’accès à l’élite blanche et l’approbation de parents qui ont sacrifié leur jeunesse derrière un comptoir. Cette contradiction la rend tour à tour arrogante et vulnérable, parfois dans la même scène. Le roman a souvent été comparé aux fresques sociales du XIXᵉ siècle, notamment Middlemarch de George Eliot et La Foire aux vanités de Thackeray.
L’île des femmes de la mer (Lisa See, 2019)
Sur l’île de Jeju, en Corée du Sud, les haenyeo — plongeuses en apnée — sont les piliers économiques de leurs familles, au sein d’une société matriarcale rare en Asie. On y suit l’amitié entre Young-sook et Mi-ja, deux adolescentes qui rêvent de prendre la relève de leurs aînées. L’occupation japonaise, la Seconde Guerre mondiale et le massacre de Bukchon en 1948 vont fissurer ce lien jusqu’à le rendre méconnaissable.
Lisa See s’est installée sur l’île de Jeju pour recueillir les témoignages des dernières haenyeo encore en vie. Cette matière documentaire donne au récit sa densité : on y apprend comment ces femmes plongent, comment elles négocient leurs prises au marché, comment leur hiérarchie interne fonctionne. L’amitié entre les deux héroïnes sert de fil conducteur, mais c’est un pan entier de l’histoire coréenne — resté longtemps tabou — que le roman éclaire.
Filles de la mer (Mary Lynn Bracht, 2018)
En 1943, sur l’île de Jeju, Hana, jeune haenyeo de seize ans, aperçoit un soldat japonais se diriger vers sa petite sœur Emi, restée sur la plage. Pour la protéger, elle se précipite hors de l’eau et se laisse enlever à sa place. Hana est déportée en Mandchourie et devient l’une de ces « femmes de réconfort » — euphémisme glaçant qui désigne les esclaves sexuelles de l’armée impériale japonaise.
Le roman alterne entre le calvaire d’Hana en 1943 et la quête d’Emi en 2011, vieille femme venue manifester devant l’ambassade du Japon à Séoul pour réclamer justice. Premier roman de Mary Lynn Bracht, Filles de la mer restitue un crime de guerre longtemps passé sous silence, et encore difficilement reconnu par le Japon. On estime que jusqu’à 200 000 femmes ont subi le même sort qu’Hana.
Créatures du petit pays (Juhea Kim, 2021)
En 1917, la Corée ploie sous l’occupation japonaise. Jade, issue d’une famille de paysans pauvres, est vendue à une école de courtisanes — les gisaeng — à Séoul. Elle y croise Jungho, orphelin et fils d’un chasseur de tigres, qui survit grâce à la débrouille dans les rues de la capitale. Leurs chemins se croisent, divergent et se retrouvent sur près d’un demi-siècle, de la lutte pour l’indépendance à la guerre de Corée.
Le pays change autour de Jade et Jungho — et les change avec lui. Le Séoul des cafés modernistes et des sociétés secrètes des années 1920 laisse place à la guerre, puis à la dictature. Juhea Kim ne cherche pas à idéaliser ses personnages : chacun, pour survivre, devra renoncer à quelque chose — un idéal, un amour, parfois sa propre intégrité.
Geisha (Arthur Golden, 1997)
Au Japon des années 1930, Chiyo, neuf ans, est arrachée à son village de pêcheurs et vendue à une maison de geishas de Kyoto. Rebaptisée Sayuri, elle gravit un à un les échelons d’un univers régi par des codes stricts — rivalités féroces entre geishas, alliances calculées avec les protecteurs fortunés, obéissance absolue aux aînées. On suit son parcours dans le monde clos des okiya, des salons de thé aux quartiers réservés de Gion.
Arthur Golden a travaillé pendant plus de dix ans sur ce livre, nourri notamment par les confidences de Mineko Iwasaki, ancienne geisha. Le Japon d’avant et d’après-guerre apparaît ici depuis un angle inhabituel : celui de femmes dont le quotidien oscille entre raffinement extrême et précarité permanente. Le film de Rob Marshall, sorti en 2005, a contribué à la renommée internationale du roman.
Pour que chantent les montagnes (Nguyễn Phan Quế Mai, 2020)
Việt Nam, 1972. Depuis les montagnes, la petite Hương et sa grand-mère Diệu Lan regardent Hà Nội brûler sous les bombardements américains. Cette scène inaugurale ouvre un récit qui couvre un siècle d’histoire vietnamienne — de l’occupation française à la chute de Sài Gòn — à travers le destin de la famille Trần.
L’autrice, née en 1973 dans un village du nord du Việt Nam, s’est appuyée sur l’histoire de sa propre famille pour écrire ce premier roman en anglais. Le récit aborde sans détour la grande famine de 1945, la réforme agraire imposée par le Việt Minh et les ravages de l’agent orange. Le regard est celui des civils vietnamiens, trop souvent absents des récits occidentaux sur cette guerre.
Le Club de la chance (Amy Tan, 1989)
À San Francisco, quatre immigrées chinoises se retrouvent autour d’une table de mah-jong pour fonder le « Joy Luck Club ». Toutes ont laissé derrière elles une vie en Chine — mariages forcés, exodes, enfants abandonnés sur les routes. Leurs filles, nées aux États-Unis, peinent à comprendre ces mères qu’elles jugent trop rigides, trop superstitieuses, trop chinoises.
Le roman se construit comme un jeu de voix : huit femmes, quatre mères et quatre filles, livrent tour à tour leur version des faits. Ce qui paraît absurde ou cruel vu depuis la Californie des années 1980 prend un tout autre sens une fois replacé dans la Chine d’avant 1949. Adapté au cinéma en 1993 par Wayne Wang, Le Club de la chance reste un texte fondateur de la littérature sino-américaine.
Les Cygnes sauvages (Jung Chang, 1991)
Ce récit autobiographique couvre la vie de trois générations de femmes chinoises au XXᵉ siècle. La grand-mère de l’autrice, née en 1909, subit la tradition des pieds bandés avant d’être donnée comme concubine à un seigneur de la guerre. Sa fille s’engage dans les rangs communistes et épouse un cadre du Parti. Jung Chang, quant à elle, grandit dans le culte de Mao avant de vivre les persécutions de la Révolution culturelle.
Vendu à plus de treize millions d’exemplaires et traduit en trente-sept langues, ce livre est toujours interdit en Chine. Son intérêt tient à la position de l’autrice : ni dissidente de la première heure, ni victime passive, Jung Chang a grandi dans une foi sincère envers le régime avant d’en subir l’arbitraire. Le lecteur suit donc quelqu’un qui a d’abord dénoncé ses voisins avant d’être dénoncée à son tour — et cette lucidité rétrospective, sans complaisance, donne au témoignage son poids.
Mille soleils splendides (Khaled Hosseini, 2007)
Après le succès mondial des Cerfs-volants de Kaboul, Khaled Hosseini revient en Afghanistan. Mariam, fille illégitime d’un homme riche, est mariée de force à un cordonnier brutal de Kaboul. Laila, sa cadette d’une génération, grandit dans une famille éduquée avant que la guerre civile ne détruise tout. Quand les deux femmes se retrouvent sous le même toit — épouses du même homme —, leur hostilité initiale cède peu à peu devant l’évidence : elles n’ont personne d’autre.
Le récit couvre trente ans d’histoire afghane, de l’invasion soviétique au régime des Talibans. Hosseini y décrit la condition des femmes afghanes sans euphémisme : interdiction de travailler, de sortir seule, de consulter un médecin homme — et pas de médecin femme. Ce qui empêche le livre de verser dans le simple réquisitoire, c’est l’attention portée aux gestes du quotidien, aux moments de complicité volés entre Mariam et Laila.
Les Matins de Jénine (Susan Abulhawa, 2006)
L’histoire débute en 1948, lors de la Nakba — la « catastrophe » — qui voit des centaines de milliers de Palestiniens chassés de leurs terres. La famille Abulheja quitte le village d’Ein Hod pour le camp de réfugiés de Jénine. Le roman suit leurs descendants jusqu’à la seconde Intifada, entre la Cisjordanie occupée et les États-Unis.
Susan Abulhawa, elle-même née de parents réfugiés palestiniens, raconte le conflit à hauteur d’une famille : l’arrachement à la terre, la vie dans les camps, la perte d’un enfant enlevé par un soldat israélien. Le livre ne prétend pas à la neutralité — il adopte clairement le point de vue palestinien —, mais sa force tient à la précision de ce qu’il décrit : l’odeur d’un verger d’oliviers, le vacarme d’un camp de réfugiés à l’aube, la lenteur des files d’attente aux checkpoints.
No Home (Yaa Gyasi, 2016)
Au XVIIIᵉ siècle, sur la Côte-de-l’Or (actuel Ghana), deux demi-sœurs naissent dans des villages rivaux sans jamais se connaître. Effia épouse un officier britannique et vit dans les étages du fort de Cape Coast. Esi est enfermée dans les cachots du même fort, avant d’être déportée vers les plantations de coton en Amérique. De ces deux destins naissent deux lignées parallèles que le roman suit sur trois siècles.
Chapitre après chapitre, Yaa Gyasi alterne entre le Ghana — guerres tribales, colonisation, indépendance — et les États-Unis — esclavage, ségrégation, incarcération de masse. Chaque personnage hérite de blessures qu’il n’a pas vécues et tente, avec plus ou moins de succès, de s’en affranchir. Premier roman de l’autrice, écrit à vingt-six ans et souvent rapproché de l’œuvre de Toni Morrison, No Home a reçu le PEN/Hemingway Award en 2017.
L’autre moitié de soi (Brit Bennett, 2020)
Mallard, Louisiane, années 1950. Dans cette petite ville fondée par et pour des Noirs à la peau claire, les jumelles Vignes grandissent dans l’ombre du lynchage de leur père. À seize ans, elles fuguent vers La Nouvelle-Orléans. Desiree finira par revenir à Mallard avec sa fille à la peau noire. Stella, elle, a rompu tout lien avec sa sœur pour se faire passer pour blanche — et n’est jamais revenue.
Le roman court des années 1950 aux années 1990 et suit, à travers les deux sœurs et leurs filles, les conséquences d’un mensonge fondateur. Brit Bennett aborde la question du passing — cette pratique par laquelle des personnes noires à la peau claire adoptaient une identité blanche — sans jugement moral : elle expose le poids du secret et les renoncements qu’il implique. Le personnage de Reese, compagnon transgenre de Jude (la fille de Desiree), prolonge la question par un autre versant : lui aussi vit avec l’écart entre ce que son corps montre et ce qu’il sait être.
La Maison aux esprits (Isabel Allende, 1982)
Premier roman d’Isabel Allende, La Maison aux esprits suit la famille Trueba au Chili, de la Belle Époque aux années 1970. Esteban Trueba, patriarche autoritaire et conservateur, bâtit un domaine agricole et une fortune politique. Face à lui, les femmes de sa lignée — Clara la clairvoyante, Blanca l’amoureuse, Alba la militante — refusent, chacune à sa manière, l’ordre qu’il prétend leur imposer.
Le roman accompagne les bouleversements politiques du Chili, de la réforme agraire au coup d’État de 1973, et y insuffle une dimension surnaturelle héritée du réalisme magique latino-américain. Les esprits, les prémonitions et les phénomènes inexpliqués font partie intégrante du quotidien des Trueba. Allende, nièce du président Salvador Allende renversé par Pinochet, a écrit ce livre en exil, d’abord comme une lettre à son grand-père sur le point de mourir.
L’Équilibre du monde (Rohinton Mistry, 1995)
Bombay, 1975. Indira Gandhi décrète l’état d’urgence. Dans ce contexte de répression politique, quatre personnages se retrouvent dans un même appartement : Dina Dalal, veuve qui lutte pour préserver son indépendance ; Ishvar et Omprakash, oncle et neveu tailleurs issus de la caste des Intouchables ; et Maneck, étudiant venu des montagnes du Nord. Aucun d’entre eux n’a choisi cette cohabitation, mais la ville et le régime ne leur laissent guère le choix.
Rohinton Mistry, né à Bombay et installé au Canada, livre un roman-fleuve sur l’Inde des années 1970, ses stérilisations forcées, ses bidonvilles rasés et ses programmes de « réhabilitation ». Mais c’est aussi un récit sur la solidarité entre des êtres que tout sépare — caste, classe, éducation — et que les circonstances contraignent à cohabiter. L’équilibre entre eux est fragile ; le régime, la ville et le système de castes font tout pour le rompre.