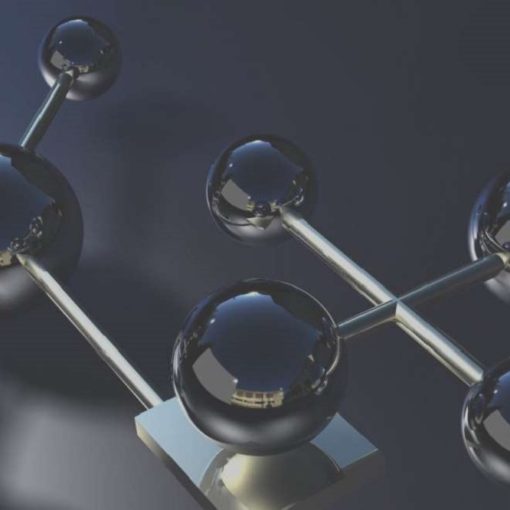Se préparer au CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie, c’est aligner sa pratique sur les attendus du référentiel : réalisation au banc (enchaînement opératoire, précision, finition), lecture/production de documents techniques (croquis, vues, cotes), technologie des matériaux (alliages, traitements, brasures) et prévention–sécurité en atelier (HSE, gestes et postures). Les épreuves évaluent la capacité à organiser le poste, choisir l’outillage, respecter des tolérances, contrôler, corriger et argumenter ses choix.
La sélection qui suit a été pensée pour couvrir ces compétences cœur : consolidation des bases (tracer, scier, limer, ajuster, braser, polir), projets progressifs pour s’entraîner dans les conditions de l’examen, ressources ciblées en dessin et sertissage, sans oublier diagnostic et réparation.
1. Manuel d’apprentissage du bijoutier-joaillier (Watchprint, 2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable manuel d’atelier, ce volume synthétise les fondamentaux que tout·e candidat·e au CAP doit maîtriser : organisation du poste (établi, outillage, entretien), enchaînement des opérations (tracer, scier, limer, ajuster, braser, émeriser, polir) et contrôles dimensionnels. Conçu par des enseignants et praticiens, il propose une progression claire et très visuelle, ponctuée d’exercices gradués qui mettent l’accent sur la régularité des traits, la précision des angles et la maîtrise de la chauffe. Les pas-à-pas expliquent la logique du geste et les critères d’évaluation à se fixer pour s’auto-noter comme au banc d’examen.
On apprécie l’approche « terrain » : chaque technique est associée à des repères de sécurité, aux erreurs classiques (sciage en biais, surchauffe, défaut d’affleurement) et aux moyens de correction. Les planches illustrées et les vues d’outils (bocfil, triboulet, filières, bouterolles, pinces, chalumeau) aident à ancrer les bons gestes et à choisir l’outil adapté. Un volet matière/alliages, un rappel sur les brasures et une initiation à la logique des gabarits-contrôle complètent l’ensemble.
L’ouvrage reste enfin utilisable au quotidien : papier épais, mise en page aérée, schémas lisibles, index efficace. On y revient pour planifier une séance, vérifier un ordre opératoire ou faire un « débrief qualité ». Bref, un compagnon robuste, pensé pour rester ouvert sur l’établi, qui fait gagner du temps entre deux entraînements et sécurise la progression jusqu’aux épreuves.
Comment l’utiliser ?
- Planifier un parcours de 6 à 8 semaines : 2–3 exercices par chapitre, en chronométrant vos temps.
- Tenir un carnet d’atelier : croquis du montage de brasure, paramètres (flux, brasure, buse), défauts rencontrés et corrections.
- Refaire les mêmes pièces avec une jauge de tolérances (± 0,1 mm/± 0,2 mm) pour travailler la régularité.
- Filmer vos gestes clés (sciage, brasage) et comparer à la séquence décrite pour corriger posture et orientation.
- Avant chaque séance, lister les contrôles qualité à effectuer (planéité, équerrage, centrage, polissage).
2. Techniques de la bijouterie (Eyrolles, 2014)
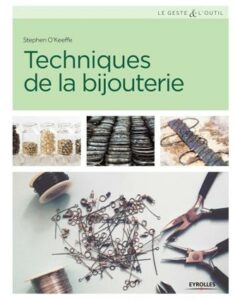
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Vingt leçons structurées et près de quarante projets : ce livre sert de passerelle entre acquis de base et réalisation autonome. Très pédagogique, il détaille la mise en place de l’atelier, présente l’outillage indispensable et montre comment fabriquer certains outils soi-même. Les chapitres couvrent sciage, limage, pliage, mise en forme, brasage, texturage et finitions, avec un focus sur l’argent (alliage de référence au CAP) et des transpositions vers d’autres métaux.
La force de l’ouvrage réside dans ses pas-à-pas riches en images : ils explicitent les trajectoires d’outil, l’ordre des opérations et les paramètres de chauffe afin d’éviter la destruction d’un assemblage. Les projets proposés (bagues, pendentifs, attaches, éléments de chaîne) montent en difficulté et entraînent à la planification : préparation, ébavurage, contrôle, reprise. Chaque réalisation inclut des critères d’évaluation ; on peut ainsi transformer le projet en sujet d’entraînement chronométré.
L’auteur insiste sur l’autonomie et la rigueur : évaluer la section nécessaire, anticiper la dilatation, gérer les contraintes internes. Les encadrés « astuces » et « erreurs fréquentes » font gagner des mois d’essais. Pour un·e candidat·e, c’est une boîte d’entraînement prête à l’emploi : on y revient pour standardiser ses méthodes, documenter les paramètres et bâtir une routine de contrôle qualité avant polissage.
Comment l’utiliser ?
- Programmer 1 projet/semaine et bâtir une check-list « ordre de fabrication ».
- Refaire un même projet en variant épaisseurs et sections pour comprendre les limites de brasage et de mise en forme.
- Noter températures/flux/brasures utilisés et l’état des surfaces avant/après polissage.
- Utiliser les projets pour simuler une épreuve pratique (temps limité, critères de finition).
- Photographier étapes et défauts : créer une bibliothèque d’erreurs pour progresser.
3. Le grand livre du travail des métaux pour les bijoux — Outils, techniques et inspirations (Pyramyd, 2023)
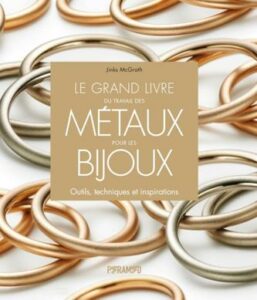
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Réédition souple d’un classique : 320 pages qui couvrent l’outillage, les propriétés des métaux (précieux et communs) et les procédés traditionnels comme leurs adaptations contemporaines. L’ouvrage se distingue par ses tableaux pratiques (outils, sections, applications), ses pas-à-pas soignés et ses incursions inspirantes dans le travail de créateurs, utiles pour nourrir culture et imagination.
Pour le CAP, le livre joue un double rôle. D’une part, c’est un manuel technique structuré : découpe, brasage, limage, assemblages, finitions et techniques spécialisées (émaillage, gravure, texturation). D’autre part, c’est un aide-mémoire riche en rappels de sécurité, en points de vigilance et en repères professionnels (préparation de commande, coûts matière, choix d’alliage selon usage).
On apprécie la clarté des schémas et l’approche comparative : chaque méthode est replacée dans un contexte d’atelier (plaqué vs fil, tube vs plein, fermoirs alternatifs). La progression logique aide à croiser savoir-faire et culture : on y puise des idées de projets modulables en niveau CAP et un vocabulaire précis pour justifier ses décisions lors de l’oral. Un outil précieux pour monter en assurance et gagner en cohérence sur l’ensemble du processus.
Comment l’utiliser ?
- Monter une bibliothèque d’éprouvettes (textures, brasures, finitions) à partir des pas-à-pas.
- Pour chaque bijou d’entraînement, rédiger un processus opératoire et cocher les étapes.
- Exploiter les tableaux pour choisir section/alliage au plus juste (poids, rigidité, coût).
- Préparer l’oral : relever 5 exemples de créateurs et les rattacher à vos choix techniques.
- Utiliser les chapitres « applications » comme mini-sujets chronométrés.
4. Le sertissage de bijoux (Eyrolles, 2020)
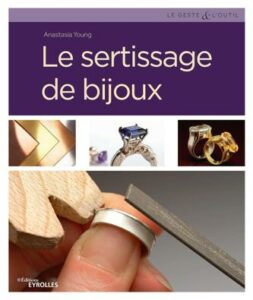
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Parce que le CAP inclut souvent des éléments sertis, ce volume spécialisé est une valeur sûre. Il présente l’outillage (échoppes, brunissoirs, fraises, moteurs), les supports (grains, griffes, clos, serti masse, serti rail, pavage) et le pas-à-pas des principaux sertis. Les points forts : abondance d’illustrations, schémas de prélimage, coupes, vues « avant/après » qui aident à visualiser l’assise parfaite et la répartition des efforts.
L’autrice insiste sur la lecture des volumes, la protection des pierres, la gestion de la pression et le polissage final. Un chapitre très utile détaille les erreurs fréquentes (assise trop large/étroite, bavures, griffes écrasées) et propose des remèdes concrets. Des conseils d’affûtage et d’entretien des outils (angles, polis) permettent de gagner en finesse sans multiplier les achats.
Pour un·e candidat·e CAP, c’est le livre à ouvrir dès que la base au banc est solide : il transforme la théorie en gestes reproductibles et sûrs, réduit l’approximation et sécurise la finition autour de pierres fragiles. Les tableaux récapitulatifs et le lexique facilitent l’argumentation technique à l’oral et la rédaction d’un ordre opératoire clair.
Comment l’utiliser ?
- Avant un serti, dessiner la coupe (siège, angle, réserve de matière), puis comparer au schéma du livre.
- S’entraîner sur éprouvettes (cuivre/argent) en série : même pierre, 5 montages différents.
- Constituer un set minimal d’échoppes et noter affûtages/angles efficaces selon le serti.
- Photographier chaque étape ; annoter défauts et corrections — créer une grille d’auto-contrôle.
- Programmer un exercice de polissage sélectif pour protéger les pierres sensibles.
5. Dessin de bijoux (Chenelière, 2008)
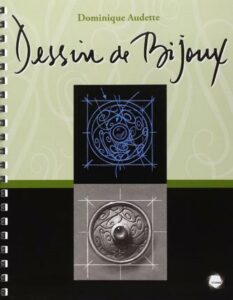
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour traduire une idée en communication technique lisible, ce manuel très didactique aligne près d’un millier de croquis et modèles progressifs. Il guide du dessin technique (vues, coupes, cotes) au croquis d’intention, en passant par le rendu d’ombres et de lumières et la représentation des pierres. Chaque chapitre introduit une notion simple, puis des exercices ciblés ; chaque modèle est décomposé étape par étape.
Le point fort pour le CAP : le livre apprend à choisir la bonne technique de dessin selon l’usage (conception, préparation à la fabrication, archive, présentation). Les planches consacrées aux bagues, boucles, pendentifs et aux sertis constituent un support direct pour intégrer vocabulaire et proportions. La reliure spiralée permet un travail à plat à côté du banc.
En suivant les séquences, on gagne en précision, en justesse des volumes et en vitesse — trois qualités clés lors des épreuves où l’on doit passer de l’idée au plan réalisable. Les exemples commentés et les exercices chronométrés aident également à stabiliser une écriture graphique propre, reproductible et partageable avec un patron, un professeur ou un examinateur.
Comment l’utiliser ?
- 20 min/jour de croquis chrono : 5 poses de 4 min (formes simples → bijou abouti).
- Construire une bibliothèque de gabarits (ovales, navettes, tailles de pierres).
- Refaire les planches « pierres » en variant échelle et inclinaison pour travailler le brillant.
- Pour chaque projet d’atelier, produire une vue technique + une vue de présentation.
- Entraîner un gouaché minimal (or/argent) pour gagner en lisibilité à l’oral.
6. Précis de bijouterie-joaillerie — Jeweller’s Handbook (Atlande, 2013)
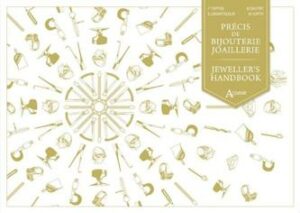
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Petit format, grand service : ce précis tient du vade-mecum à garder sur l’établi. Rédigé et illustré par une équipe issue de la formation et de l’atelier, il condense l’essentiel des techniques du métier dans une forme très visuelle : repères d’outils, gestes clés, « comment faire », schémas d’assemblage et listes de contrôles.
L’intérêt pour le CAP est double. D’abord, réviser vite avant une séance (ou une épreuve) ; ensuite, vérifier un détail en cours de route (orientation de lime, ordre de brasage, mise en place d’un fermoir, base d’un serti). Les fiches thématiques facilitent l’auto-diagnostic : à quelle étape se situe mon défaut ? que vérifier au contrôle ? On trouve aussi des encadrés sécurité et des astuces de mise en place qui rassurent lorsqu’on travaille sous contrainte de temps.
Si vous possédez déjà un « grand » manuel, ce précis joue la complémentarité : il pointe l’essentiel et évite de se perdre. Sa maquette claire, ses dessins nets et sa portée « atelier » en font un compagnon naturel des premières années de pratique et une ressource portable pour les révisions de dernière minute.
Comment l’utiliser ?
- Avant de commencer, lire la fiche-geste concernée (3–4 min), puis poser le livre à portée de main.
- Annoter les pages avec vos réglages personnels (hauteur de bocfil, abrasifs préférés).
- En fin de séance, cocher la liste des contrôles et relire la fiche « défauts courants ».
- Créer des onglets (sciage, brasures, finitions, serti, fermoirs) pour l’ouvrir instantanément.
- Utiliser les schémas pour briefer un binôme ou demander un retour rapide.
7. L’entretien et la réparation de bijoux (Eyrolles, 2013)
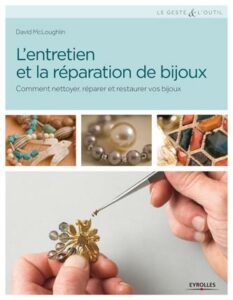
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Apprendre à fabriquer, c’est aussi apprendre à réparer. Ce guide très illustré (plus de 500 photos) couvre le diagnostic, le nettoyage, la remise en état et la restauration de pièces précieuses ou fantaisie. On y trouve des cas concrets : fermoirs, chaînes, colliers de perles, sertis desserrés, pierres décollées, usure d’anneaux, reprises de soudures. Chaque fiche décrit le matériel, l’ordre opératoire et les points de vigilance.
La première partie donne des repères historiques et stylistiques pour identifier une pièce : utile pour choisir une méthode adaptée et argumenter vos choix. La seconde déroule des pas-à-pas outillés et insiste sur la sécurité (solvants, ultrasons, poussières, risques thermiques) ainsi que sur la documentation (photos, notes, matériaux), afin de tracer les interventions et de pouvoir justifier vos décisions.
Intérêt CAP : muscler votre sens du diagnostic et votre précision sur des opérations de faible tolérance — excellent entraînement au contrôle qualité et à la reprise fine. L’ouvrage apprend aussi à formaliser une procédure claire, transférable, qui sera valorisée à l’oral comme en atelier.
Comment l’utiliser ?
- Assembler un kit de réparation (brasures, micro-fraises, perles/fil) et réaliser 1 cas/semaine.
- Tenir une fiche de suivi : état initial, hypothèses, intervention, résultat, conseils au client.
- Construire un arbre de diagnostic (mécanique/serti/soudure/alliage) à partir des cas récurrents.
- Vous filmer sur les opérations délicates (reprise de serti) pour contrôler pression et angle.
- Établir une procédure de nettoyage adaptée aux alliages/pierres sensibles.
Conseils pratiques de révision
- Mixez pratique et théorie : 2 h de banc = 20 min de lecture ciblée + 10 min de prise de notes.
- Standardisez vos sujets d’entraînement : mêmes contraintes que l’examen (temps, tolérances, contrôle).
- Montez un tableau de brasures (alliage, température, flux, risques) et affichez-le à l’atelier.
- Tenez un journal d’atelier avec photos : en 6 semaines, la progression saute aux yeux.
- Constituez votre nuancier de finitions (émeris, brosses, pâtes à polir) : un mémo visuel efficace.
Références
- Référentiel officiel du CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie (PDF – Éduscol)
- Présentation Éduscol – Option Bijouterie-Joaillerie
- Fiche RNCP 36336 – Compétences et activités visées (France Compétences)
- ONISEP – CAP ATBJ, option Bijouterie-Joaillerie (objectifs, programme, débouchés)
- ONISEP – Option Bijouterie-Sertissage
- ONISEP – Option Polissage-Finition
- Bulletin officiel – Arrêté de création du CAP « Art et techniques de la bijouterie-joaillerie » (2008)