Préparer l’agrégation d’histoire-géographie implique d’aligner son travail sur les attendus précis du concours : problématiser finement une dissertation, conduire un commentaire de document en historien(ne), produire des croquis et schémas normés et argumentés, maîtriser les échelles et les temporalités, actualiser ses références bibliographiques et chiffrées, et soutenir à l’oral une leçon claire, structurée, suivie d’un entretien maîtrisé. Les jurys évaluent autant la rigueur méthodologique (plans démonstratifs, transitions actives, définitions exactes) que la capacité à mobiliser des exemples localisés, des données sourcées et une cartographie lisible.
Dans cette perspective, la sélection qui suit privilégie des bouquins directement exploitables pour les questions d’histoire et de géographie au programme (savoirs de fond, concepts opératoires, études de cas, France et mondes, outils cartographiques), ainsi que pour les formats d’épreuves (écrits et oraux). Objectif : vous fournir un socle fiable et des méthodes immédiatement transférables pour répondre aux exigences du cursus et aux standards des rapports de jury.
1. Méthode pour le commentaire et la dissertation historiques (Armand Colin, 5e éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Outil de chevet pour l’agrégatif, ce manuel couvre l’ensemble du savoir-faire historique attendu aux concours : décodage d’un libellé, formulation d’une problématique, architecture d’un plan, rédaction, transitions, gestion du temps. Il ne se contente pas d’une « check-list » : il montre comment penser un commentaire de texte (littéraire, statistique, iconographique), hiérarchiser des arguments, et articuler la preuve (citations, chiffres, exemples) au propos.
La partie sur la dissertation va au-delà des poncifs : elle apprend à tenir un fil directeur, à piloter l’alternance exposition/démonstration, à éviter les plans mécaniques, à installer des transitions actives et une conclusion qui ouvre sans diluer. L’ouvrage se distingue par ses exemples concrets et ses exercices corrigés : on y pioche des tournures, des gestes de méthode, des modèles de bibliographie.
Pour l’agrégation, sa force tient à la transversalité : les procédés décrits valent du médiéval au contemporain, et des écrits à l’oral. En bref, le manuel qui fait gagner des points « invisibles » : ceux de la rigueur, du rythme, et de la netteté argumentative — exactement ce que repèrent les jurys.
Comment l’utiliser ?
- Construisez une fiche « gestes essentiels » (accroche, problématique, transitions, conclusion) et relisez-la avant chaque entraînement.
- Entraînez-vous à problématiser cinq sujets en 15 minutes : ne rédigez pas, aiguisez seulement l’axe et le plan.
- Reprenez les exercices corrigés : réécrivez l’introduction ou la transition pour mieux verrouiller les étapes.
- Pour le commentaire, faites trois lectures successives (repérage/structure/contexte) en chronométrant.
- À l’oral, recyclez les « tics utiles » de l’ouvrage (annonces courtes, transitions signées, synthèses partielles).
2. La dissertation en histoire (Armand Colin, 4e éd., 2025)
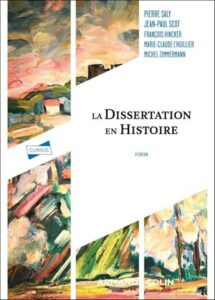
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Classique modernisé, cette nouvelle édition met la composition historique au centre : lecture fine du sujet, cadrage chronologique et spatial, construction du plan démonstratif, gestion des exemples. L’ouvrage excelle à montrer que la dissertation n’est jamais une juxtaposition : c’est un enchaînement raisonné où chaque partie résout un nœud de la problématique.
Les nombreux exemples (sujets toutes périodes) valent « salles de musculation » : ils montrent ce qu’est une introduction tendue, un plan qui progresse, une transition qui pousse l’argument. Les conseils de rédaction (phrases-cales, balises de lecture, articulations logiques) sont immédiatement transférables à l’agrégation.
On apprécie aussi les pages sur la gestion du temps : découpage des 5 minutes initiales, repérage des impasses, calibrage des parties. À l’heure où les jurys attendent une pensée située et des références sûres, ce manuel aide à qualifier les exemples (référence, précision, pertinence) et à éviter l’érudition flottante. En somme : un guide qui muscle la stratégie autant que l’écriture, parfait en complément du livre n° 1.
Comment l’utiliser ?
- Alternez sujets flash (plan détaillé en 40 min) et compositions complètes (4–5 h) pour travailler rythme et endurance.
- Dressez une banque d’accroches (faits, citations brèves, chiffres solides) classées par période et thème.
- Entraînez les transitions : réécrivez celles des corrigés, puis rédigez les vôtres en 3–4 lignes maximum.
- Après chaque copie blanche, codez les faiblesses (P : plan, Ex : exemples, Tr : transitions, Concl : conclusion) et corrigez-les de façon ciblée.
- Travaillez en binôme : échangez introductions et plans, puis débriefez sur la cohérence problématique ↔ plan.
3. Manuel de cartographie — Principes, méthodes, applications (Armand Colin, 2e éd., 2025)
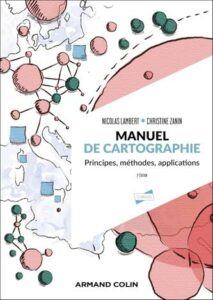
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Indispensable pour réussir croquis, schémas et cartes de synthèse, ce manuel propose un pas-à-pas cartographique : choix des fonds, typologie des données, variables visuelles (forme, taille, texture, hachures), contraintes de lisibilité, et surtout mise en scène de l’argument.
La nouvelle édition, revue et augmentée, intègre des méthodes actuelles (données massives, SIG, webmapping) sans perdre la boussole du concours : une carte sert une démonstration. Les chapitres détaillent les pièges fréquents (légendes bavardes, figurés redondants, palettes trompeuses), proposent des workflows reproductibles et une grille d’auto-évaluation (pertinence, hiérarchie, équilibre).
L’iconographie abondante et commentée permet d’apprendre par l’exemple : on y voit ce qui marche et pourquoi. Atout crucial pour l’agrégation : l’ouvrage apprend à articuler carte et texte (renvois précis, micro-commentaire, cohérence des échelles). Résultat : des productions propres, hiérarchisées, qui gagnent des points à coup sûr, à l’écrit comme à l’oral.
Comment l’utiliser ?
- Constituez un kit de figurés (3–4 familles) et engagez-vous à les réemployer pour gagner en vitesse et cohérence.
- Faites des séries : 5 cartes sur le même thème mais échelles/objectifs différents → comparez lisibilité et message.
- Écrivez toujours un micro-commentaire (4–5 lignes) pour vérifier que la carte « parle » bien de la problématique.
- Avant une blanche, préparez une boîte à légendes (blocs déjà hiérarchisés) à adapter en 5 minutes.
- Filmez-vous en train de légender : traquez surcharge, désalignements, titres trop longs.
4. Croquis et schémas de géographie — Réussir les épreuves aux concours et examens (Armand Colin, 2021)
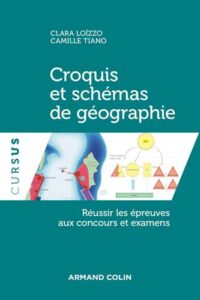
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Pensé pour les concours, cet ouvrage guide pas à pas la réalisation des productions graphiques : schémas, croquis, graphiques et tableaux. Il répond aux questions concrètes qui coûtent des points : combien de figurés ? Où placer un encadré ? Comment problématiser une légende ? Quelles mentions obligatoires ?
L’approche est très pratique : des modèles reproductibles, des étapes minutées, des cas variés (territoires, réseaux, risques, mondialisation, France dans le monde). L’intérêt pour l’agrégation est double : d’un côté, on apprend la propreté formelle (titres, hiérarchies, renvois, calage graphique) ; de l’autre, on travaille la pertinence argumentative de la légende (logique tripartite, blocs thématiques, gradients, exceptions).
Les encadrés méthodologiques neutralisent les erreurs récurrentes (doubles échelles, symboles ambigus, figurés non exclusifs). Même si la méthode vaut pour d’autres concours, l’exigence de démonstration par l’espace colle parfaitement aux attentes de l’agrégation. À garder sur le bureau pour industrialiser la production graphique.
Comment l’utiliser ?
- Constituez un répertoire de schémas (flux, réseaux, gradient centre/périphérie, hiérarchies urbaines) à mémoriser.
- Entraînez la légende-problème : trois parties vraiment démonstratives (pas descriptives), chacune avec 2–3 preuves.
- Travaillez en contrainte de temps (20–25 min) avec un gabarit A4 et un jeu de figurés limité.
- Relisez chaque croquis avec une check-list (titre-problème, orientation, échelle, sources, lisibilité à 1 m).
- Préparez des paires carte/texte : un paragraphe de commentaire qui cite explicitement 2–3 éléments de la carte.
5. Les fondamentaux de la géographie (Armand Colin, 4e éd., 2024)
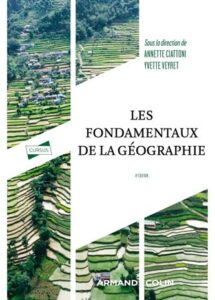
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Véritable boîte à outils conceptuelle, ce manuel collectif met au clair les grands champs de la discipline : épistémologie, approche spatiale, mobilités, mondialisation, risques, territoires, métropolisation, systèmes productifs, etc. Chaque chapitre suit un parcours stable (objectifs, notions clés, définitions, étude de cas, essentiels à retenir) qui facilite la fichage rapide.
L’actualisation (4e éd.) rend l’ouvrage particulièrement utile à l’agrégation : concepts remis à jour, bibliographies resserrées, et méthodologie des outils (carte, SIG, Internet). L’intérêt majeur pour le concours est de fournir des définitions opérationnelles (territoire, réseau, gradient, interface, transition) et des exemples récents pour illustrer la copie.
Le livre aide également à régler le « niveau de zoom » : localiser, changer d’échelle, replacer un fait dans des dynamiques. En somme, un manuel pour solidifier le socle et standardiser le langage : parfait pour éviter les approximations qui coûtent cher dans le feu de l’épreuve.
Comment l’utiliser ?
- Fichez les notions clés (définition + exemple + source) et relisez-les avant chaque entraînement de dissertation/croquis.
- Entraînez la translation d’échelle : le même fait expliqué à l’échelle locale, nationale, mondiale.
- Recyclez les études de cas en mini-encadrés (3–4 lignes) prêts à être insérés.
- Ajoutez une bibliographie miroir (2 références par notion) pour nourrir introductions et transitions.
- Lors d’une copie blanche, surlignez les concepts utilisés : vérifiez précision et cohérence avec la problématique.
6. Géographie de la France (Armand Colin, 2e éd., 2023)
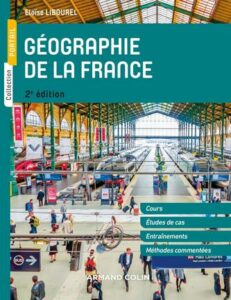
Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
La France demeure un terrain d’excellence à l’agrégation : démographie, métropolisation, mobilités, recompositions productives, environnement, position européenne et mondiale. Cette synthèse actualisée (coll. Portail) offre un cours structuré (questions-clés, définitions, focus thématiques) et une boîte à méthodes (dissertation, commentaire statistique ou topographique, croquis de synthèse, schéma fléché).
Les chapitres combinent fonds solides (diagnostics, séries, cartes) et études de cas localisées qui « accrochent » la démonstration. Les « + en ligne » permettent de vérifier les acquis et d’enrichir les exemples.
L’ouvrage est précieux pour calibrer des sujets transversaux (inégalités territoriales, transitions, mobilités) comme pour réussir un croquis de synthèse propre et convaincant. On y trouve l’équilibre nécessaire entre données (chiffres, tendances) et lectures spatiales (échelles, gradients, polarités) — exactement ce qui distingue une bonne copie d’une copie excellente.
Comment l’utiliser ?
- Pour chaque chapitre, préparez un croquis-type (fond + légende problématisée) et un schéma fléché.
- Constituez un tableau de chiffres (5–7 indicateurs à jour) avec sources, prêts à être mobilisés.
- Fichez 2–3 études de cas par thème (ville moyenne, filière, interface, risque) réutilisables.
- Faites des liens systématiques avec l’Europe/monde (flux, dépendances, rangs) pour enrichir les conclusions.
- À l’oral, entraînez un pitch de 60 s par thème (idée forte + preuve + ouverture).
7. Initial — Dictionnaire de Géographie (Hatier, 6e éd., 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Ce dictionnaire thématique met de l’ordre dans le vocabulaire de la géographie, des notions classiques (région, paysage, réseau) aux champs renouvelés (géographie culturelle, géopolitique, environnement, risques). Polyvalent, il accompagne la préparation des plans comme la rédaction des légendes : une bonne définition, juste et courte, fait gagner un temps précieux et crédibilise l’argument.
Les entrées, illustrées (cartes, schémas, tableaux), sont pensées pour le repérage rapide ; l’index étendu permet de rebondir entre notions voisines et de désambigüiser les concepts souvent mal employés (territorialisation, gradient, interface).
L’intérêt pour l’agrégation est de fournir un lexique stabilisé pour l’introduction (délimitation sémantique), les transitions (termes-pivots) et la conclusion (montée en généralité). En complément des manuels (n° 5 et n° 6), ce dictionnaire sert de garde-fou : il évite les flottements terminologiques et affine la précision — un critère que les jurys valorisent explicitement.
Comment l’utiliser ?
- Avant chaque sujet, écrivez trois définitions (notions du libellé) de 2–3 lignes, puis vérifiez-les dans le dictionnaire.
- Créez des mini-fiches contrastes (ex. : aire/territoire ; centre/périphérie ; gradient/seuil) avec exemples.
- À la relecture, traquez les glissements sémantiques (même mot, sens différent) et corrigez.
- Pour chaque croquis, ajoutez une définition-titre qui verrouille la portée exacte de la carte.
- Révisez à l’aveugle : un binôme lit une définition, vous devinez la notion et proposez un exemple.
8. Les données chiffrées en sciences sociales — Du matériau brut à la connaissance (Armand Colin, 2e éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac
Parce qu’une copie d’agrégation se juge aussi à la tenue des chiffres, ce manuel initie (ou remet à niveau) à la lecture critique des données : calculs de base (taux, indices), interprétation de tableaux et graphiques, pièges usuels (moyennes trompeuses, corrélation/causalité), et mise en mot de résultats.
Assorti d’exercices corrigés et d’extraits de presse/revues, l’ouvrage apprend à situer les chiffres (source, date, méthode), à choisir l’indicateur pertinent et à l’insérer proprement dans le raisonnement. Atout majeur pour l’agrégation de géographie (mais utile en histoire) : transformer un nombre en preuve — courte, sourcée, comparée et circonscrite (échelle, période).
Les repères méthodologiques aident à bâtir des paragraphes équilibrés (idée → chiffre → explication → nuance). En somme, un livre discret mais décisif : il évite l’approximation statistique, fiabilise la copie et renforce la crédibilité du candidat.
Comment l’utiliser ?
- Montez une banque d’indicateurs (7–10 par thème) avec définition, source, ordre de grandeur et limite.
- Réécrivez les légendes de graphiques en une phrase argumentative (cause, effet, exception).
- Entraînez la mise en mot des taux/indices : deux phrases max., une comparaison et une restriction.
- À chaque dissertation, imposez-vous deux chiffres bien contextualisés (échelle + date + source).
- Faites un audit chifré de vos copies : pertinence des indicateurs, exactitude, formulation.
Conseils de préparation complémentaires
- Adossez votre entraînement au programme : pour chaque question au programme, fixez un binôme « lecture de fond » (manuel récent) + « méthode » (dissertation/croquis) et enchaînez en conditions.
- Lisez les rapports de jury des sessions récentes : ils révèlent les lacunes récurrentes (imprécision des termes, cartes illisibles, bibliographies hors sujet) et les attendus implicites.
- Fiches actives : une notion = une définition opératoire + un exemple localisé + une bibliographie courte.
- Rythme : alternez séances « courtes et ciblées » (30–40 min, un exercice) et longues (4–5 h, copie blanche).
- Binôme critique : échangez plans, intros, cartes ; exigez-vous des preuves (référence, chiffre, localisation).
- Sobriété efficace : très peu de gras, des transitions claires, des cartes nettes : la lisibilité fait gagner des points.
Références
- Programmes officiels des concours (session 2026) — Devenir enseignant
- Sujets & rapports des jurys de l’agrégation — sessions récentes
- Description des épreuves — Agrégation externe, section Histoire
- Ressources pour préparer les concours — Géoconfluences (ENS de Lyon)
- EHNE — Articles de A à Z (Encyclopédie d’histoire numérique de l’Europe)
- INSEE — Définitions statistiques (glossaire officiel)
- IGN — Fonds de cartes et ressources pédagogiques




